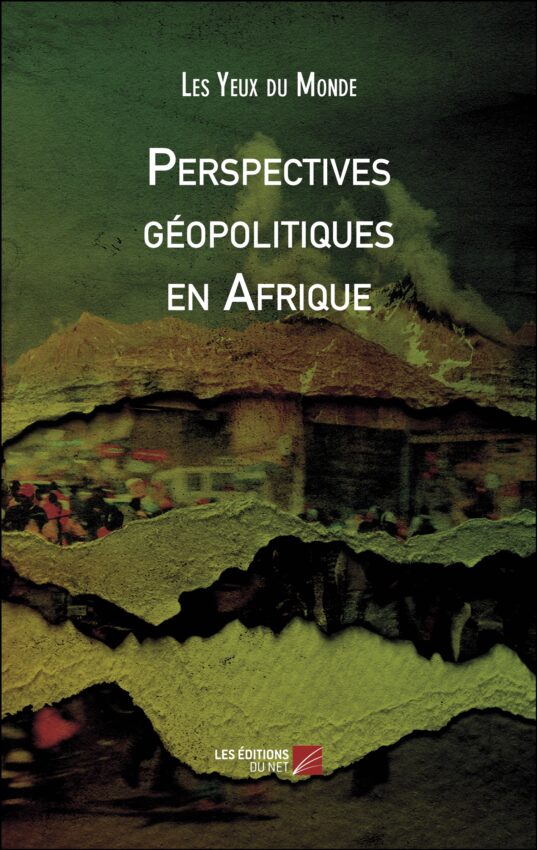Robert Schuman, Père de l’Union européenne
La Déclaration Schuman du 9 mai 1950 constitue un tournant historique pour l’Europe. Dans l’optique d’instaurer une paix durable, elle propose la mise en commun des productions de charbon et d’acier, ressources stratégiques au cœur de l’industrie de l’armement. On rendrait ainsi la guerre « non seulement impensable, mais matériellement impossible ». Une vision audacieuse et fondatrice…

Comment la diplomatie et l’intégration économique mènent à la paix
Robert Schuman est né en 1886 au Luxembourg, citoyen allemand. Son père était français, sa mère belge, fervente catholique, dont les valeurs religieuses ont profondément marqué l’éducation de son fils. Schuman ne devint Français qu’à l’âge de 33 ans, après que le Traité de Versailles de 1919 ait restitué à la France la région d’Alsace-Lorraine, où il vivait, et accordé, ainsi qu’à ses habitants, la nationalité française.
À cause de circonstances personnelles particulières et du milieu qui l’a façonné, Schuman considérait les frontières et les nationalités comme des constructions sociales d’importance secondaire par rapport à l’identité régionale. C’est ainsi qu’il est resté solidement attaché à sa région d’origine, la Moselle. Selon Nathalie Griesbeck, ancienne députée européenne, Schuman incarnait l’idéal du citoyen européen.
La Première Guerre mondiale l’a fortement marqué. Il travaillait alors comme secrétaire dans un hôpital militaire à Metz. À ce titre, il a été le témoin direct de la souffrance des gens ordinaires pris dans la tourmente de ce conflit. Ayant des liens personnels au sein des deux parties belligérantes, Schuman n’arrivait pas à comprendre comment des individus partageant la culture et les valeurs qui fondent une communauté pouvaient se faire la guerre. C’est de cette expérience que sont nées les convictions politiques qui placent définitivement la paix et la réconciliation au cœur de son engagement public. Sa Déclaration, rédigée par un petit groupe de collaborateurs, dont son ami Jean Monnet, incarne bien ces idéaux. En effet, le mot « paix » apparaît à plusieurs reprises dans ce texte assez court. Un des passages les plus marquants de la Déclaration Schuman est celui qui prédit que:
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni selon un plan unique. Elle se construira par des réalisations concrètes qui créeront d’abord une solidarité de fait« .
Contrairement à de multiples autres appels à l’intégration qui énumèrent des idéaux abstraits et des objectifs vagues, cette Déclaration proposait une initiative claire, spécifique et pratique visant à créer la paix à travers l’interdépendance économique entre des pays souverains. Elle appelait quelques États européens à s’engager dans un projet commun qui lierait leurs intérêts. Ce projet, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), a été élaboré afin de mettre en partage la production de charbon et d’acier dans le cadre d’un marché commun. Ces nouveaux liens économiques entre les différents acteurs, en particulier entre la France et l’Allemagne, devaient rendre tout conflit futur non seulement indésirable, mais matériellement impossible. Pour atteindre l’objectif ultime de la paix, il fallait donc que les économies des pays participants deviennent interdépendantes. Nombreux sont ceux qui ont cherché à reproduire ce modèle, sans en comprendre les subtilités.
Un cadre normatif et une théorie de l’intégration
Une quinzaine d’années sépare deux des plus importants courants de pensée de l’intégration régionale, le « Fonctionnalisme international » et le « Néo-fonctionnalisme ». Le premier est né au début des années 1940 avec la publication de « A Working Peace System » (1943) du penseur Britannique d’origine roumaine David Mitrany. Le second est le résultat d’une étude très fouillée de l’évolution de la CECA par le politologue américain Ernst B. Haas.
Pour le fonctionnaliste Mitrany, un monde en paix doit être régi non par des entités politiques, mais par un ensemble d’institutions techniques spécialisées chargées de satisfaire les besoins fondamentaux de toute communauté humaine : nutrition, santé, mobilité, communication… Mitrany détestait le concept d’État, structure responsable à ses yeux des conflits armés. La paix est donc l’objectif ultime du fonctionnalisme et c’est grâce à l’action efficace de ces institutions spécialisées que les États saisiront la nécessité de coopérer davantage les uns avec les autres. Cette coopération internationale les rendra progressivement obsolètes, jusqu’à les faire disparaître.
Haas, en revanche, ne faisait pas de la disparition de l’État un enjeu fondamental. Dans son ouvrage « The Uniting of Europe » (1957), les États coopèrent à la réalisation d’une initiative transnationale de nature économique et acceptent pour cela de déléguer de plus en plus de pouvoir à des structures supra-nationales. C’est ainsi que, selon Haas, le processus d’intégration en Europe formera un espace sans frontières politiques rigides, où les structures étatiques et supra-nationales se partageront l’essentiel du pouvoir. Si Haas a choisi la CECA de Schuman comme sujet d’étude, il n’y voyait pas nécessairement un instrument de paix.
Ainsi donc, même s’il existe un lien direct entre la Déclaration Schuman et le néo-fonctionnalisme de Haas, Schuman partageait sans doute davantage les aspirations de Mitrany : la paix résultant d’une coopération fonctionnelle.